LE
VISIBLE ET L’INVISIBLE
 Dans
la conduite de leur vie, les Corses, ceux du moins qui
ont vécu dans
la société « traditionnelle» rurale qui fait le principal
objet de ce chapitre sont guidés par l'idée que ce qu'ils voient,
le domaine du visible, est doublé par une face invisible, mystérieuse,
mais déterminante; en un mot que le visible est symbole, au sens premier
que les Grecs donnaient au terme: « objet coupé en deux dont deux
hôtes conservaient chacun une moitié, qu'ils transmettaient à leurs
enfants; ces deux parties rapprochées servaient à faire reconnaître
les porteurs et à prouver les relations d'hospitalité contractées
antérieurement» (Bailly, Dictionnaire Grec-Français,
1894).
Dans
la conduite de leur vie, les Corses, ceux du moins qui
ont vécu dans
la société « traditionnelle» rurale qui fait le principal
objet de ce chapitre sont guidés par l'idée que ce qu'ils voient,
le domaine du visible, est doublé par une face invisible, mystérieuse,
mais déterminante; en un mot que le visible est symbole, au sens premier
que les Grecs donnaient au terme: « objet coupé en deux dont deux
hôtes conservaient chacun une moitié, qu'ils transmettaient à leurs
enfants; ces deux parties rapprochées servaient à faire reconnaître
les porteurs et à prouver les relations d'hospitalité contractées
antérieurement» (Bailly, Dictionnaire Grec-Français,
1894).
Cette
vision de l'ordre des choses inspire aussi bien la religion chrétienne
(et particulièrement le rite catholique romain), telle qu'elle est vécue
par les Corses, les pratiques médico-magiques et, comme on le verra, les
représentations et conduites concernant les rapports de la nature et du
surnaturel. Elle sous-tend aussi la sagesse populaire telle que nous la trouvons
déposée dans les proverbes: leur forme imagée n'est pas
seulement un artifice de style; elle correspond, plus profondément à une
vision de l'ordre des choses qui voit dans le visible, l'apparent le physique,
l'expression et le reflet de l'invisible, de l'essentiel et du spirituel. Ce
n'est pas pour nous étonner quand nous savons à quel point dans
un grand nombre de sociétés l'ordre cosmique et l'ordre social
sont considérés comme homothétiques et dépendants
l'un de l'autre.
La foi chrétienne et les dévotions
populaires
La
quasi-totalité de la population corse est de confession catholique.
Toutes les autres confessions nous renvoient aux migrations récentes;
qu'il s'agisse des 8 à9 000 travailleurs émigrés maghrébins,
ou des petits noyaux de protestants ou d'israélites, qui ne dépassent
pas le millier d'individus. La population de Cargese, lieu d'implantation d'une
colonie grecque, maïniote, au XVIIIeme siècle est en partie catholique
de rite grec.
Cette situation explique déjà en partie que la religion catholique
imprègne tous les actes de la vie, privée et publique. Même
si aujourd'hui, la pratique religieuse régulière est marquée
par l'absentéisme dominical, il reste que les grands rites de passage
chrétiens - baptême, première communion, mariage et enterrement
religieux - sont observés dans des proportions avoisinant les 100 % Dans
cette massivité il y a plus que du conformisme: le poids d'une tradition
vivante et complexe, que nous allons trouver à l'œuvre dans toutes
les représentations et qui associe étroitement comme on le verra
la religion, la magie, la médecine populaire, la vision du surnaturel.
La
religion assure d'abord la protection de tous les instants. Le simple ordre
normal des choses est déjà l'œuvre du Seigneur et de ses saints. « U
tonu un casca duv'ellu c'et un santu chi prega per voi » (la foudre ne
tombe pas là où il y a un saint qui prie pour vous). Ou encore: « U
Signore da i panni secondu u freddu. » (Le Seigneur donne les vêtements
selon le froid.) On ne fait aucun projet d'avenir sans ajouter « Si Diu
vole» (si Dieu le veut). Les paysans, les bergers font bénir les
champs, les maisons, les troupeaux. Si un enfant tombe gravement malade on le
voue à saint Antoine; s'il guérit, on l'habille pendant trois ans
avec la robe de bure brune, le cordon blanc à la ceinture, et les
sandales des moines.
Parmi les saints guérisseurs on invoque en particulier:
Sainte-Lucie de
Ville di Pietrabugnu (13 décembre) pour les maux d'yeux,
Saint-Pancrace
de Casinca (12 mai) pour les rhumatismes,
Saint-Erasme (2 juin), patron des pêcheurs,
Saint-Laurent de Tralonca (10 août) pour les fièvres de Malte,
Saint-Roch
(16 août) pour les plaies.
Parmi les pèlerinages les plus importants
citons ceux de Lavasina (Brandu), de Valle d'Alisgiani, de la Santa di Niolu
et
de l'oratoire dédié à la Vierge à Santa Lucia di
Muriani. Ils ont tous lieu le 8 septembre qui est, en dehors des grandes fêtes
du calendrier chrétien, la fête religieuse la plus populaire de
l'île.
On sait que la Vierge a été proclamée par la Consulte des
Théologiens du 31 janvier 1735 « Reine et Protectrice de la Corse ».
Partout où il y a un sanctuaire dédié à la Vierge
il y a, le 8 septembre, au moins un petit pèlerinage local. Les Ajacciens,
de leur côté, vénèrent la « Madunaccia » (Notre-Dame
de Miséricorde) les 17 et 18 mars; ils en ont fait la patronne de la ville
depuis qu'en 1660 elle les préserva de la peste. A ces pèlerinages
s'ajoutent ceux de Sainte-Restitude de Calenzana (21 mai), celui de Muru (le
jour de la fête des Cinq Plaies, - le vendredi qui suit la Mi-Carême),
celui d'Oletta (le Vendredi Saint), ces deux derniers destinés à commémorer
des prodiges.
Au milieu du XIXeme siècle les bergers du Cuscione se réunissaient
le 1er août pour la Saint- Pierre, aux liens, à l'oratoire de Saint-Pierre,
construit en 1500 « Ils y venaient à cheval avec leur famille. Le
curé célébrait une messe; ils dînaient en plein air,
ils dansaientt au son du fifre puis au retour, chaque cavalier cherchait à montrer
son adresse... Un autre guérisseur du bétail, mais dans l'arrondissement
de Bastia, à Borgo, était vers la même époque, saint
Appien, martyr, qui avait été maréchal-ferrant avant d'être évêque
d'Alexandrie. On prétendait posséder une clef qu'il avait forgée
de ses mains et dont l'application sur le front de l'animal, en invoquant le
saint, le guérissait, quelle que fût la maladie... saint Martin
serait invoqué dans le même but à Bocognano et à Evisa » .Les
bergers et paysans de Castagniccia montaient en pèlerinage, le 1er août, « sur
les ruines de l'ancienne cathédrale d'Accia située aux flancs du
San Petrone, au carrefour d'anciens chemins muletiers qui menaient aux vallées
limitrophes pressées en cercle au pied du San Petrone: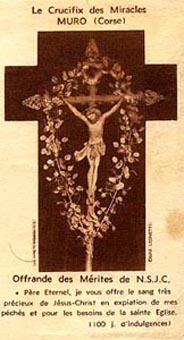 piève
d'Ampugnani, Rostino, Vallerustie, Orezza, Casacconi...»
piève
d'Ampugnani, Rostino, Vallerustie, Orezza, Casacconi...»
Saint Martin est invoqué dans toutes les occasions où l'homme attend
de Dieu qu'il lui dispense les fruits de la terre. Il est par excellence le saint
de l'abondance, et la croix, dite « de Saint-Martin» est tracée
sur toutes choses en gestation: sur le champ labouré, sur le tas de blé vanné,
sur le lait caillé et sur le brocciu, avant qu'on ne le mette dans les « fattoghje»,
sur la pâte du pain à cuire (on la trace avec la « cunzula » la
raclette qui sert à nettoyer le pétrin), sur le pain avant qu'on
ne le mange. Dans les jardins on place des croix bénies à la messe
de Saint-Antoine (crucette di Sant'Antone). Enfin on fait porter aux enfants
des scapulaires (« breve » ou « orazione ») constitués
de divers objets ou fragments d'objets retirés d'une cérémonie
religieuse: un fragment du cierge du Miserere, des pétales de fleurs ayant
orné la statue d'un saint lors de sa fête, un bout de charbon de
la bûche principale allumée à la Noël...
Cette
imprégnation religieuse de la vie quotidienne se marque aussi dans
les gestes les plus simples.
On compte les boisseaux de blé ou les bêtes du troupeau en disant
non pas « un, deux, trois...» mais « Nome di Diu (1) »; « e
di i Santi » (2) ; « e di a Trinita » (3) ; on poursuit par
les chiffres ordinaires. La sacralisation du quotidien s'étend aussi à l'espace
de la communauté. On a l'occasion de dire que le terroir de la communauté est
protégé par des chapelles. C'est on ne peut plus vrai à Mùrsiglia
(Cap Corse) dont toutes les crêtes sont gardées par des chapelles:
Saint-Augustin au nord-est, Notre Dame des Grâces à l'est, Sainte-Lucie
au sud, un couvent vers la mer. Mais cette sacralisation apparaît aussi
dans les légendes de fondations d'églises: qu'il s'agisse de l'érection
miraculeuse, en une nuit, d'une église comme celle de Saint-Quilicus d'Alisgiani;
ou du choix de l'emplacement déterminé par l'intervention surnaturelle
de bœufs blancs ou d'une mule.
Cette foi chrétienne dont on voit, par ces quelques exemples, très
incomplets, l'omniprésence ne va pas sans un certain anticléricalisme
dont la Corse n'a pas l'exclusivité, et qui semble venir du Moyen Age.
Le profond et sincère respect qu'inspire le prêtre dans sa fonction
sacerdotale et dans son habit n'exclut pas une certaine défiance irrévérencieuse à l'égard
de l'homme lui-même. Elle s'exprime dans les histoires gaillardes où le
prêtre joue le rôle d'un séducteur, dans les dictons
(« ln cumpania ancu u prete piglio moglia » : en compagnie même
le prêtre prit femme), ou dans l'expression courante pour désigner,
avec une nuance péjorative, quelqu'un qu'il vaut mieux ne pas nommer,
ou qu'on ne connaît pas: « E u prete chi l'ha fattu » (c'est
le prêtre qui l'a fait). Cette contradiction n'est pas aussi étonnante
qu'il y paraît. Le fait est que, « le clergé corse, étroitement
lié au peuple dont il est issu, en partage les difficultés, l'idéal
national et patriotique» Il a donc joué un rôle important
dans les luttes nationales mais aussi dans les querelles politiques locales,
et s'est ainsi rapproché, dans son mode de vie et ses mœurs,
du peuple villageois qu'il conduisait.
Faut-il rappeler que l'hymne national de la
Corse est à la fois un hymne
religieux et un chant de guerre?
L'intrication entre les domaines du spirituel
et du temporel est visible, d'une
certaine façon dans l'organisation des communautés. Sur des documents
d'archives des XVIeme et XVIIIeme siècles, montre que les confréries
ont joué dans les périodes troublées un rôle social
et économique non négligeable, en réconciliant les ligues
de familles déchirées par des questions d'intérêt
ou d'honneur, ou tout au moins en modérant l'expression de leurs conflits.
Dans certains cas, c'est dans le cadre de la confrérie que se prennent
les décisions les plus urgentes concernant la vie de la communauté: « La
confrérie apparaît comme le défenseur et la sauvegarde du
régime communautaire gravement menacé par les luttes de clan et
l'opposition entre bergers et agriculteurs, plus gravement menacée encore
par l'influence et la prépondérance des notables dans la vie sociale
et économique de la communauté.»
On situe les confréries dans une longue et patiente entreprise de « promotion
du laïcat » qui leur donne leur dimension spirituelle.
Entre
ces deux pôles, - qui parfois arrivent à se conjuguer dans
une entreprise de réforme politique et morale de la société comme
celle qu'amorcèrent, vers 1450 les confréries de « Battuti» (Flagellants)
-, prennent place plusieurs sortes de confréries: confréries de
la Sainte-Croix, tournées vers la représentation de la Passion;
confréries de la Miséricorde, qui s'occupaient des hôpitaux,
des prisonniers, des condamnés à mort; confréries dites « pacere » dont
les statuts et l'action visaient à la pacification, et à la réconciliation
des ennemis.
Là où elles se sont maintenues jusqu'à aujourd'hui, les
confréries ont gardé essentiellement un rôle spirituel; mais
dans une stricte indépendance à l'égard de la hiérarchie
ecclésiastique; indépendance matérialisée par leur
siège, réservé aux réunions, généralement
une chapelle située à côté de l'église. Les
confréries élisent régulièrement leurs prieur,
sous-prieur et conseil.
Il existe aussi, mais plus rarement, des confréries féminines.
(« Curdunaghje.»)