Décrite
tantôt comme une esclave soumise à la tyrannie d'un
rustre, tantôt comme une maîtresse-femme régnant
avec autorité sur une nombreuse tribu où domine
l'élément masculin, la femme Corse voit son image
osciller sans cesse entre ces deux représentations également
schématiques et réductrices.
La réalité n'est
pas facile à cerner qui se dérobe à une
analyse partielle, partiale, trop rationnelle ou trop affective,
souvent faite de l'extérieur et toujours par des hommes,
donc encore plus facilement mythifiée et mythifiante.
Vraie
pour toutes les femmes, sous tous les cieux, cette phrase
de deux féministes italiennes -Ida Magli et Ginevra
Conti Odorisio- l'est également pour les femmes
corses: «L'image féminine, amoureusement cultivée
par les hommes, celle qui se reflète dans la culture...
une image sombre et lumineuse, nette et ambiguë, tendre
et cruelle, protectrice et dangereuse, faible et puissante,
porteuse à la fois de vie et de mort. » Avant de
tenter une approche de la condition féminine en Corse
au siècle dernier, commençons par voir évoluer
ces femmes dans leur habillement. Entre a saccula brune de pannu
corsu, austère vêtement en poil de chèvre,
porté par leurs aïeules du siècle précédent
et la mode « parisienne» adoptée par les classes
supérieures de la bourgeoisie insulaire, peut-on définir
un habillement quotidien moyen des femmes corses au XIXeme siècle? |

Paysannes a Alata
|
Un des éléments caractéristiques du vestiaire féminin
au XVIIIeme siècle était la faldetta (prononcée falletta
dans le nord- est), dont l'abbé de Germanes donne la description en
1771 : «Les femmes portent par-dessus leurs corsets la faldetta, qui
est une jupe plissée et fort longue par derrière, qu'elles relèvent
dessus leur tête en forme de voile. La couleur est d'un bleu turc, couleur
favorite des Corses ». La faldetta fut, dès son adoption, la marque
distinctive des « femmes de condition », et au fur et à mesure
que s'imposèrent d'autres modes, elle fut dévolue aux femmes
des classes populaires jusqu'à ne plus subsister à la fin du
XIXeme siècle que comme vêtement de deuil.
Nous pouvons suivre les modifications qui interviennent peu à peu dans
les mœurs vestimentaires en étudiant l'évolution des termes
dans la poésie populaire, et notamment dans les voceri: dans une lamentation
funèbre publiée en 1843 où une femme de famille aisée
de la Casinca, Maddalena Albertini, de A Penta, pleure la mort de sa sœur,
pauvrement mariée à un berger de Prunu, en Ampugnani, nous
trouvons cette indication:
Eu ùn aghju mai cridutu
Di truvatti le fallette
Mi vogliu cavà una rota
E' in dossu a ti vogliu mette
Nous voyons là se manifester parfaitement la différence entre
riches et pauvres: ces dernières sont habillées de drap corse
(u pannu) et non d'indienne (u culore), et portent encore la faldetta archaïque
au lieu de la jupe plus moderne, a rota. Détrônée, la faldetta
est remplacée par u mèseru, grand voile rectangulaire qui couvre
la tête et le buste, et auquel succéderont, plus tard, u mandile
di capu et a viletta. Nous trouvons le mèseru dans un autre voceru comme
signe des classes aisées. Santia pleure son mari Ghjuvanni F...
de U Viscuvatu :
U mèseru mi vogliu caccià
Vogliu mette le follette
E' po mi ne vogliu andà
Cum'è tutte le puverette
Pour les autres parties du vêtement, les femmes au XIXéme siècle
portent désormais presque toutes la robe ou la jupe d'indienne. Celle-ci,
moins fréquente, est portée avec corsage, veste ou spencer:
u casacchinu et u caracco.
Enfin, quant à l'utilisation du noir, on apprend qu'il s'est répandu
comme marque du deuil dès le début du XIXéme siècle,
en même temps que le bleu des faldette. Les couleurs tendent à s'assombrir,
après 1870, du fait du succès du caracco presque toujours noir,
et de l'abandon de l'indienne bariolée au profit de la laine qui est
le plus souvent noire, grise, marron ou café (avec néanmoins
une certaine permanence du bleu et du rouge).
En définitive, « la vérité est dans la multiplicité des
cas » et « il n'y a pas de modèle unique » dans
un pays où les contraintes de l'économie de subsistance soumettent
les habitants à des impératifs stricts d'utilisation des
matières
premières et d'adaptation individuelle qui font qu'on ne peut en
aucun cas parler de « costume national corse ». Gardons-nous
donc de certaines et récentes schématisations qui opposent à l'idée
traditionnelle d'un habillement extrêmement sobre et sévère,
celle d'extravagances rutilantes, enrubannées et galonnées...
Ainsi que celle-ci:
La famiglia di Trinchettu
T'hà trattatu cun ingannu
E' perfinu m'onu dettu
Ch'è tù purtave lu pannu
Et enfin cette dernière:
E' falai sempre pienghjendu
Da A Penta à Sant'Antone
Dissi : « e figliole di Babbu
Bramanu ancu lu culore ! »
LA
CONDITION DES FEMMES
Les voyageurs du XVIIIeme siècle notent tous avec le même étonnement
l'extrême dureté de la condition féminine en Corse.
« Chargées comme des mulets et venant quelquefois de cinq à six
lieues avec un quintal de foin dans un drap sur leur tête»(Goury
de Champgrand)
«On est étonné des poids énormes qu'elles portent
sur leurs têtes, et que l'habitude paraît leur avoir rendus légers» (Gaudin
).
Boswell, lui, constate qu'elles sont chargées par les hommes de transporter
sur leur tête ses propres bagages de village en village.
Même si cette condition des femmes est vue avec les yeux effrayés
du rationalisme européen, il n'en reste pas moins vrai qu'elle était
extrêmement rude. Témoins ces quelques proverbes qui eux sortent
de la bouche des Corses: Hè megliu à esse mule orezzinche ch'è donne
lutinche. Le sort des mules d'Orezza, région de muletiers par excellence,
est plus enviable que celui des femmes de la piève de Lota, au nord
de Bastia, réputée pour ses marchandes ambulantes :
(Da e donne è da i boi Cacciane quant'è tù poi) « Tire
le maximum de profit du travail des femmes et de celui des bœufs ».
La part du travail de la femme était -c'est unanimement reconnu - supérieure à celle
de l'homme, car outre a purtatura, la corvée de portage qui leur était
dévolue (les hommes ne portant dans leur vie qu'une seule chose: le
cercueil) et qui les transformait en véritables portefaix lors de la
construction d'édifices, les femmes facianu in casa è fora, avaient
une double tâche, l'entretien domestique et une participation totale à tous
les travaux extérieurs (moissons, récoltes...).
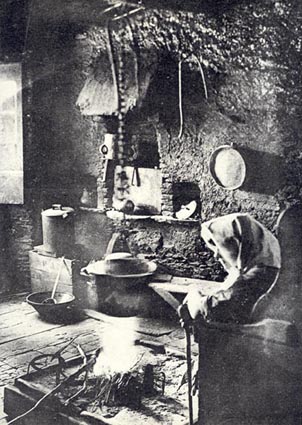
|
Femme
au fucone |
On n'insistera
jamais assez sur ce que pouvait être une vie de labeur d'une femme Corse,
elle qui n'avait jamais un moment de répit, pas même lors des
veillées hivernales, où elle continuait à filer, tisser, écosser
les haricots, elle qui réussissait à accomplir un double travail,
revenant de la fontaine ou allant à la cueillette, le tricot à la
main! Et comment passer sous silence la condition morale et affective des jeunes
femmes Corses pendant les premières années de leur mariage? Comment
ignorer le statut d'étrangère de la jeune épousée
sous le toit de son mari qui était aussi celui de toute sa belle-famille?
Enlevée d'abord à sa maison natale, quelquefois aussi à son
village d'origine, la femme corse abandonnait les lieux familiers de son enfance
et ce déracinement n'était pas sans conséquences car la
maison qui l'accueillait n'était pas toujours bienveillante envers la
nouvelle venue. Seule la naissance d'enfants mâles la faisait accéder à un
statut plus confortable et lui permettait en même temps d'établir
des liens de prédilection avec les hommes de son sang. Compensant par
là des rapports affectifs souvent difficiles avec son entourage, la
mère Corse répondait par un surinvestissement sur ses fils qui
faisait naître des relations œdipiennes. On peut déceler
là, sans risque d'erreur, une des raisons qui rendaient les mères
Corses toutes puissantes au point de faire dire à certains que notre
société était matriarcale.
LE
MYTHE DU MATRIARCAT
Le rôle des femmes Corses, le pouvoir des femmes Corses, le matriarcat
Corse! Autant de mots magiques et mystérieux, lourds d'affectivité,
de tendresse filiale, si souvent employés à propos d'une réalité transformée.
Nous savons aujourd'hui -ou du moins nul ne devrait plus l'ignorer - que le
matriarcat est un mythe forgé au XIXéme siècle et qu'il
n'a cessé d'alimenter les polémiques passionnées des historiens
et préhistoriens, ethnologues et anthropologues, sociologues, philologues,
juristes et psychologues. L'Oxford Dictionary définit ainsi le terme
de matriarcat: « système social organisé sur l'autorité et
le pouvoir féminins, par analogie avec celui qui est fondé sur
le pouvoir masculin dans le patriarcat ». Or, il est unanimement admis
que même dans les sociétés à filiation matrilinéaire
et résidence matrilocale, le seul domaine, le seul « pouvoir» reconnu
aux femmes est celui de la famille et non le pouvoir social, politique et d'État.
Le terme de matriarcat n'a donc pas de raison d'être; il n'en reste pas
moins vrai que les femmes, bien qu'écartées depuis toujours du
monde du pouvoir et par là exclues du monde du savoir, ont pu parfois
apparaître comme détenant une certaine puissance: songeons, par
exemple, aux pratiques magiques et aux fonctions mantiques.
Mais le monde des magiciennes, devineresses, prophétesses et sorcières
est l'envers du monde sacerdotal, le domaine du sacré étant réservé aux
seuls hommes. Impure par essence à cause de ses menstrues, la femme
s'est toujours vue exclue des initiations conduisant à la détention
des secrets, donc de l'autorité, du pouvoir, du « transcendant ».
Le principe féminin étant passif, comme celui de la terre, tandis
que le principe masculin est actif, comme celui du ciel, il va en découler
pour la femme les notions obligées de douceur, soumission et humilité.
Ces images lui imposeront un rôle dans lequel elle va se couler pour
toujours: celui d'une vierge pure, puis d'une épouse féconde
et d'une mère vénérée. Attentive à ne pas
s'écarter d'une voie qui la mènerait vers l'autre face de cette
réalité, la face négative, effrayante, celle de la putain,
de la sorcière, de la réprouvée, la femme Corse va s'appliquer à ne
pas transgresser les valeurs primordiales et gratifiantes pour elle de la chasteté.
Peut-on, dans ces conditions, parler de l'égalitarisme des sexes dans
la société corse ? Non, si l'on considère l'iniquité du
sort des petites filles pour qui l'instruction était moins importante
que celle des petits garçons, non, si l'on songe à la façon,
dont était jalousement surveillée la « vertu » de
la jeune fille: e giuvanotte ùn devenu guardà di l'omi ch'è i
straglieri di i scarpi. Non, si l'on sait ce qu'était l'attaccà,
cette façon de déshonorer publiquement une jeune fille en effleurant
ses cheveux ou sa coiffe, non, si l'on réalise que la femme corse était
frappée d'incapacité juridique, c'est-à-dire qu'elle avait
besoin de mesures de protection au même titre que les mineurs, les fous
et les faibles d'esprit, qu'elle ne pouvait contracter aucune action juridique
sans autorisation masculine, celle de son père ou de son mari.
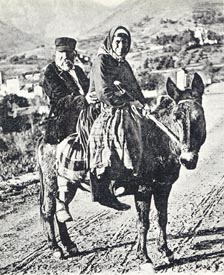
|
Paysans
corses |
Alors, quel était ce mystérieux « matriarcat insidieux » dont
parle Jean Noaro faisant allusion au rôle de conseillère et d'instigatrice
de la femme devenue épouse et mère? Quelle était cette
puissance occulte des femmes Corses? Cela mérite réflexion car
il est vrai que la mère Corse acquérait une influence au sein
de la famille, que personne ne lui contestait. Il est certain qu'ayant atteint
un âge respectable, la femme était investie d'un certain pouvoir.
Une phrase de Monique de Fontanes, à propos de la femme de l'Italie
méridionale, nous éclaire parfaitement à ce sujet: « Mais
un jour se renversent les rôles. Débarrassée du danger
d'être jeune, la femme vieille acquiert peu à peu une autorité immense,
dont la puissance cachée va souvent bien au-delà de celle des
hommes. Appuyée sur la vénération que leur confère
l'honneur d'être une mère respectable, les vieilles femmes deviennent
les redoutables gardiennes de tout ce qui les a écrasées. Elles
exercent sur les jeunes femmes, nouvellement entrées au foyer une véritable
tyrannie dans le lieu même dont elles ont, elles-mêmes, été les
prisonnières.» Voilà les maîtres-mots : le pouvoir
exercé au foyer, «l'honneur d'être une mère respectable » et « débarrassée
du danger d'être jeune ». Ce pouvoir que la femme obtient peu à peu
est celui de régner sur les affaires domestiques et non sur les affaires
publiques. En outre, elle ne l'exerce qu'à travers sa descendance mâle,
cette influence est indirecte et passe par « ses hommes », mari,
fils. Enfin, c'est seulement lorsqu'elle n'est plus menstruée et ne
peut plus apporter le déshonneur, que l'homme accorde du crédit à la
femme.
Cette morale coercitive d'une civilisation du paraître, les femmes l'ont
intégrée jusqu'à en devenir les plus farouches garantes
et ne plus y voir oppression ni contrainte. Faisons une fois encore appel aux «voceri »,
ces monuments de la poésie insulaire, révélateurs parfaits
de la société traditionnelle Corse avec ses élans et ses
tensions.

|
Voceri |
Dans
l'explosion de leurs passions, les vocératrices sont
toutes à la fois insolentes et respectueuses, soumises et irrévérencieuses,
parfois révoltées mais aussitôt normalisées à la
règle de la culture masculine. Admiratives devant les exploits de leurs
hommes, mais méprisantes envers les femmes, donc envers elles-mêmes,
et complaisantes dans leur propre péjoration, elles exaltent l'image
de la femme comme servante douce et vierge pieuse et fustigent, avec violence
les manquements féminins à l'ordre mâle. Ecoutons-les pleurer
la mort de leurs frères, de leurs fils, de leurs maris en des métaphores
qui disent leur beauté, leur force et leur courage.
« Erati la me culonna
Erati lu me puntellu
Erati la me grandezza
Erati lu me fratellu »
« Lu me grandi di curagiu
Rispettu di Ii me torti»
« Avà si chi l' aghju persu
Lu dirittu di ragioni »
« Questi si ch'eranu omi
Più fieri ch'è Ii serpenti »
Puis les voici disant les qualités de leurs filles, vertueuses et candides,
mais si hardies à la tâche:
« Eri tù cusi stimata
E' cusi piena d'onore
E' po cusi adduttnnata
ln le cose di u Signore
Altru ch' è divuzione
Nun ti si truvava in core »
« Era di lu Paradisu
Lu to core innamuratu »
« Ella ùn mi mandava à legne
A' mulinu nè à funtana
Perchè à mè la mio figliola
Mi tenia da piuvana »
Et les voilà enfin, déchaînées dans leurs flots
de haine et de malédiction envers d'autres femmes, jetant la honte et
le déshonneur sur elles:
« Per avè tumbatu à tè
Nun s'onu cacciatu corne
Chi ne truveranu sempre
Preti è frati le so donne»
LES
FEMMES ET LA LANGUE CORSE
Comment, dans des structures si fortement patriarcales de mépris de
la féminité et d'infériorisation de leur être, ne
pas comprendre les raisons qui ont conduit les femmes Corses, plus fortement
et plus rapidement encore que les hommes, aux mécanismes de l'aliénation
culturelle?
Prisonnières de leur rôle, les femmes ont été entraînées
plus facilement dans le processus d'assimilation à la culture française:
pour être une jeune fille attrayante, prête à remplir ses
fonctions d'épouse et de future mère, la femme a dû lutter
afin de se débarrasser d'une image considérée comme vulgaire
alors que le prestige de la langue française commençait à s'imposer.
Albert Memmi a fort bien analysé dans Portrait du colonisé ce
qu'il nomme «l'amour du colonisateur et la haine de soi» : « La
première tentative du colonisé est de changer de condition en
changeant de peau...
.jpg)
|
Métier
a tisser |
L'ambition
première du colonisé sera d'égaler
ce modèle prestigieux, de lui ressembler jusqu'à disparaître
en lui. » De peur de paraître arriérées, en marge
du progrès, paysanne au sens péjoratif du terme, les femmes
ont appris à parler le français, pour elles-mêmes d'abord,
car c'était un signe de culture et d'appartenance aux classes supérieures,
et pour que leurs enfants accèdent à l'instruction et à l'élévation
sociale. Mais elles ont également éprouvé le besoin
de modifier leur Corse pour le rendre plus policé, édulcoré, « raffiné »,
en effaçant les marques infâmantes de la ruralité. C'est
ainsi que les bourgeoises des villes, puis toutes les citadines, et enfin
l'ensemble des femmes se sont acharnées à gommer ce qui était
tenu pour de la rusticité, afin de paraître distinguées
et élégantes.
Il n'était pas rare, hier encore, d'entendre affirmer dans les villes
que u corsu hè a lingua di e serve, parlanu cum'è i pastori.
Besoin de libération et d'émancipation pour certaines, désir
d'avoir un statut social supérieur, espoir enfin de voir leurs enfants échapper à une
condition ressentie comme humiliante: celle de berger, d'agriculteur, que
d'efforts les femmes Corses n'ont-elles pas fait dans leur recherche éperdue
de« l'élégance » nécessaire!
Les résultats ont été à la hauteur de leurs aspirations:
rares sont les femmes au-dessous de trente-cinq ou de quarante ans capables
de prononcer un Corse non estropié, non déformé, non
altéré:
r grasseyé, consonnes dégéminées et bien d'autres
défauts, les femmes transmettent à leurs enfants une pauvre
langue mutilée, dont les structures phonétiques et la musicalité sont
en passe de devenir en tous points identiques à celles du français.

|
Cardeuses de laine |
Ecoutées
mais obéissantes, vénérées mais
méprisées, respectées mais assujetties, aimées
mais humiliées, les femmes de Corse étaient comme toutes
leurs sœurs de la planète. Et tous les discours sur leur prétendu
pouvoir ne pourront jamais qu'occulter la violence de la domination qu'elles
ont subie, masquer leur identité niée, taire qu'on leur ôtait
la liberté à chaque instant de leur vie.
Ni Faustina Gafforj, ni Rusanna Serpentini, ni la Monaca Rivarola, ni Maria
Ghjentile ne sont la preuve de l'existence des femmes Corses, parce que
les panthéons n'ont jamais empêché la subordination, la servitude
et la dépendance.
Ghjermana de ZERBI (1984)



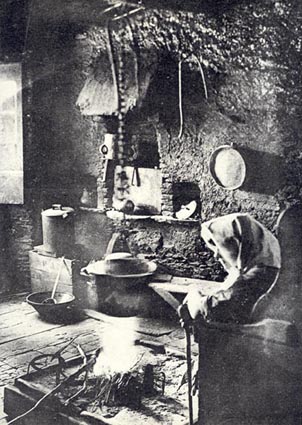
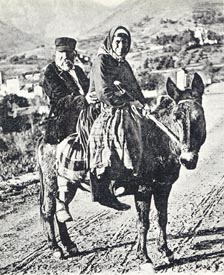

.jpg)



